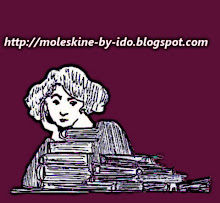Sortie précipitée du 21 qui redémarre déjà, stylo entre les dents, version classique à remettre dans dix minutes et hâtivement construite pendant le trajet mouvementé roulée sous le bras droit, tandis que le gauche redresse la sacoche remplie de livres et de feuillets épars qui glissent. Sur les marches, d’autres retardataires lambinent, se saluent, embrassent le vide, s’étreignent. Rien n’indique que les cours vont commencer hormis les portes qui se ferment le long des couloirs. Aujourd’hui comme hier, les marches de l’Institut de la rue Gay Lussac, à deux pas de l’institut d’océanographie, sont rarement vides en matinée. Fantôme ou souvenir ?
Pas de sonnerie non plus pour marquer la fin des cours. Les professeurs et maîtres de conférence opéraient millimétriquement et ne dépassaient que très rarement le délai imparti. Discipline et rigueur pour les uns, habitude due à la répétition des mêmes phrases des années durant pour les plus anciens, moins intéressés par la transmission pédagogique que par l’élevage en batterie de chercheurs inféodés. Les couloirs étaient tordus, habillés de linoléum sale, les murs souffraient d’une pelade de papier jauni. A l’époque, on fumait encore dans les couloirs de l’Institut, certains enseignants las s’y adonnant même dans les salles de classes au nez tordu et à la barbe des premiers étudiants hygiénistes. La machine à café du couloir au rez-de-chaussée, celle qui donnait sur la seule salle que l’on avait osé rebaptiser Amphi en hommage à un homme qui y était mort, connaissait peu de succès.
Le rythme des cours se succédant souffrait de la nonchalance des promenades des enseignants qui, entre deux groupes, allaient étancher leurs soifs aux cafés du carrefour. Ainsi, tout le monde s’y retrouvait, les étudiants entrants pouvant guetter du coin de l’œil la silhouette familière de leurs maîtres à travers la devanture. Chaque groupe avait son troquet et le plus prisé était paradoxalement le moins authentique. Il s’agissait de la salle de petit déjeuner de l’hôtel qui le surplombait, ce qui en interdisait l’accès aux cerveaux estudiantins encore embrumés avant 10h30. Le gérant, un corrézien moustachu, bonhomme et jamais économe en plaisanteries envers les familiers, nourrissait la troupe affamée aux têtes trop remplies d’hyperbates et de diphtongues, de rios Manzanares bus mille fois par le même âne, de défis donjuanesques au Ciel, de romantisme colombien, d’eaux fortes de Goya, du vacarme et de l’éclat terni des armures emportées par les sbires de Pizarro dans les forêts andines. Pour ne pas séparer les groupes identifiés, il fermait les yeux sur les sandwiches apportés de la boulangerie voisine dès lors que cela ne lui faisait pas concurrence, pratique rare dans le quartier où le repas de étudiants se faisait sous l’œil de fauves de serveurs entraînés à ne pratiquer aucune tolérance.
Les vitres de son établissement, qui n’offrait pas plus d’une dizaine de tables, étaient dotées de rideaux de voile de concierge et, avec peu d’entraînement, chacun était capable de reconnaître de l’extérieur la silhouette des comparses installés au premier rang. L’exercice était d’ailleurs déterminant dans le choix d’assister, ou non, au cours du matin, du début d’après-midi ou du soir. Pour peu qu’ils eussent deviné la présence d’un ami plus intéressant qu’un cours de linguistique et c’en était fini des phonèmes et des syntagmes.
L’établissement fermant assez tôt – préparation des tables matinales oblige – ceux qui s’étaient attardés pouvaient choisir de traverser la rue et d’aller se masser dans l’arrière salle de la Bonbonnière, dont le nom était aux antipodes de l’ambiance typiquement bistrot parisien qu’on y trouvait. Il étalait des banquettes luisantes jusqu’au fond d’une arrière salle très prisée et se trouvait être l’endroit de prédilection de certains professeurs, qui en occupaient évidemment l’avant-salle et le comptoir, et donc le lieu à fréquenter pour certains étudiants en veine d’obtenir des heures d’enseignement contre le serment de devenir l’homme-lige des mentors à courtiser. Selon les enseignants en position de pouvoir, on se découvrait alors des vocations improbables de médiéviste ou d’historien démographe (très en vogue après le putsch d’une historienne monomaniaque et ambitieuse, qui garda longtemps les rênes de l’Institut), sans forcément avoir de goût pour la matière traitée.
Certains professeurs distillaient leur cynisme en offrant le café, les jours de grève de bus ou veilles de week-end prolongés, qui vidaient les amphis et remplissaient les bistrots. Sur 300 candidats au poste envié d’enseignant en faculté, un seul serait élu et pourrait gagner sa vie confortablement en ne dispensant que deux à trois heures de cours par semaine, le reste du temps pourrait être égoïstement consacré à la recherche. Les 299 autres seraient des crevards nantis de Capes ou, pour les plus malins, d’agrégations, et descendraient à la mine quotidiennement pour tâcher de trouver quelques pépites lumineuses dans les esprits noirs comme la houille de collégiens et lycéens abrutis de sous-culture.
Le discours, s’il était entendu, avait rarement l’impact voulu et les années glissaient à mesure que s’entassaient les unités de valeur, sans pour autant déterminer le choix d’une orientation moins dévastatrice. Pourquoi penser concrètement à l’avenir alors que le cocon confortable des cours, des TD, des partiels, des examens finaux anesthésiait méthodiquement toute velléité de mûrir et de devenir adulte responsable ? Les conversations les plus tendues portaient principalement sur les bases du droit de conquête des territoires qui formaient maintenant l’Amérique du sud, sur la supériorité des vers de Francisco de Quevedo sur ceux de Luis de Gongora, sur la possibilité ou non d’une rédemption pour Don Juan selon qu’il fût celui de Tirso de Molina ou de Zorrilla, ou encore sur la difficulté qu’il y avait à traduire dans la langue de Cervantes un chapitre de la Recherche ou un extrait de Zazie dans le métro.

L’actualité et le tourbillon du monde contemporain se perdaient sous les
sabots de Rossinante, de Babieca (la monture du Cid Campeador) et des destriers de Cortés et de Cabeza de Vaca. Les cours de civilisation du XXe siècle retroussaient volontiers leurs manches pour aller plonger les mains dans les coups d’Etat militaires trimestriels de l’Espagne du règne d’Isabelle II et s’y perdaient longuement avant de revenir, non sans réticence, à la tentative du 23 février 1981.
Cet univers familier tenait lieu de bulle où n’entraient que les initiés, méprisant les camarades ayant choisi de poursuivre leur cursus dans des universités parisiennes éprises de modernité et n’élevant pas la culture classique en péage obligatoire. Apprentissage d’un snobisme universitaire qui finissait, avec le recul, par sembler dérisoire car offrant peu de portes de sortie.
Que restait-il réellement de tout cela aujourd’hui ?
La culture chèrement acquise se diluait dans le nivellement des exigences attendues d’élèves auxquels on ne demanderait guère de savoir plus qu’une vague maîtrise du présent de l’indicatif et de savoir gloser sur les articles d’El Pais au mieux, de Vocable au pire (clandestins du Rio Grande, droits de l’Homme à Cuba et des extraits de livres modernes quasiment tous écrits par des journalistes). Les contacts s’étaient étirés à se perdre, un ou deux mariages les premières années réunissaient encore puis, au gré des jeux d’affectation des élus de l’Education Nationale éloignant impitoyablement de la rue Gay Lussac, finissaient par se couper, et le lien tombait comme sous la main invisible d’Atropos.
Demeurait la nostalgie des heures oublieuses, plus vivace encore lorsque le 21 freinait au droit de l’Institut et que le regard se perdait parmi les silhouettes qui en occupaient les marches de leurs bavardages, cherchant à y retrouver un regard familier, une tête connue, quelque chose de plus tangible que la valse des souvenirs.
 La chanson populaire, la chanson réaliste, la chanson française telle qu'on la pratiquait dans certains cabarets à la haute époque germanopratine est devenue une pièce de musée. Pire, l'apprécier est devenu signe de mauvais goût aux yeux d'ayatollahs qui ne jurent que par les règles d'un solfège complexe (et il s'agit là d'une litote). Comment connaître ou se remémorer pourtant les grandes heures d'une poésie aujourd'hui en désuétude, déformée, contrainte, soldée aux règles de la déconstruction et du ver blanc, orpheline de rimes, pétries de sens accouchés aux divans des psychanalystes qui ont pignon sur rue? Est ce ainsi que les hommes vivent? Le Rainer Maria Rilke que l'on chantait sans pour autant le citer n'évoque plus d'échos. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus, mais la poésie simple des mots qui chantent n'est déjà plus. Elle se doit désormais aux fards de la complexité des modes, aridité, zen, haikus en pagaïe. Mais que l'on célèbre le frisson de ceux qui au lieu de se noyer dans l'hiver se sont baladés dans le printemps de ces yeux taillés en amande, oui, comme à Ostende, et comme partout, et l'on se retrouve qualifié de populaire, voire de populacier. Qui a défini ces ukases culturels? Qui peut se permettre de décider que telle forme artistique est noble et telle autre ne l'est pas?
La chanson populaire, la chanson réaliste, la chanson française telle qu'on la pratiquait dans certains cabarets à la haute époque germanopratine est devenue une pièce de musée. Pire, l'apprécier est devenu signe de mauvais goût aux yeux d'ayatollahs qui ne jurent que par les règles d'un solfège complexe (et il s'agit là d'une litote). Comment connaître ou se remémorer pourtant les grandes heures d'une poésie aujourd'hui en désuétude, déformée, contrainte, soldée aux règles de la déconstruction et du ver blanc, orpheline de rimes, pétries de sens accouchés aux divans des psychanalystes qui ont pignon sur rue? Est ce ainsi que les hommes vivent? Le Rainer Maria Rilke que l'on chantait sans pour autant le citer n'évoque plus d'échos. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus, mais la poésie simple des mots qui chantent n'est déjà plus. Elle se doit désormais aux fards de la complexité des modes, aridité, zen, haikus en pagaïe. Mais que l'on célèbre le frisson de ceux qui au lieu de se noyer dans l'hiver se sont baladés dans le printemps de ces yeux taillés en amande, oui, comme à Ostende, et comme partout, et l'on se retrouve qualifié de populaire, voire de populacier. Qui a défini ces ukases culturels? Qui peut se permettre de décider que telle forme artistique est noble et telle autre ne l'est pas?