L'amour – dans le sens de ce qui retient attachés l'un à l'autre pour une durée indéterminée deux êtres – a-t-il une valeur ? Par valeur on entendra : est-il monnayable ou non ?
A quel prix l'une des deux composantes d'un couple est-elle prête à sacrifier l'autre ?
Ces questions qui semblent si modernes et fruits d'une société où l'on semble considérer que ce qui porte une étiquette seul mérite qu'on s'y arrête, où règnent en maître des signes extérieurs d'opulence qui ne sont reconnus que dès lors qu'on peut donner leur prix, où le moindre geste se monnaye en heures supplémentaires et RTT, ces questions sont posées à l'aube du Xxème siècle par un diplomate poète, un homme qui ne laisse de surprendre tant on a coutume de le condamner à la naphtaline des sacristies et à la cire des bibliothèques poétiques.
Ces questions, c'est Paul Claudel qui les pose dans une pièce intitulée l'Echange.
Et l'on assiste, surpris d'abord, au déferlement de phrases poétiques qui résonnent et se heurtent aux oreilles peu familiarisées, comme les vagues sur la grève de cet océan omniprésent qui hante les nuits de Louis Laine, anti-héros pathétique au destin tragique dont les rêveries s'abreuvent d'un métissage qui prend racine dans les mythes des anciennes peuplades indiennes.
Images suggestives, rêves aquatiques et délires liquides lèchent le sable de la plage sur laquelle donne la maisonnette où s'agite, servante et épouse bruissant comme une abeille contre une vitre fermée, la jeune Marthe, l'épouse ravie aux terres agricoles de France, l'ingénue éprise d'absolue qui voulait voir la mer et l'entraperçut un jour dans les yeux d'un Laine qui lui offrait de l'accompagner.
La poésie prend son envol dans un staccato - non sans évoquer le jazz des premières années - avec Thomas Pollock, brasseur d'affaires yankee, l'homme qui « est riche comme un roi »,qui se demande « où est la règle de vie si un homme... ne cherche pas à Avoir une chose qu'il trouve bonne »; il a beau détenir le pouvoir de l'argent, il reconnaît en Marthe la pureté que rien n'achète, mais tenté par la piètre image qu'il a de Laine, il exerce son pouvoir maléfique tel un Méphistophélès profitant du désespoir de Faust.
Mais Laine n'est pas désespéré, il est perdu pour les autres, il court après des chimères, il trace perpétuellement une tangente dans laquelle on ne peut s'empêcher de voir l'éloge de la fuite, non comme une salvation mais comme une malédiction.
Et c'est dans le bras d'une actrice sudiste dénuée de scrupules, qui lui offre -bien que mensongèrement – la liberté de celle qui est « toute pour tous », qui ne connaît l'exclusivité que dans le multiple et dans la foule des yeux qui brillent pour elle, qui brillent avec elle, c'est dans les bras de Lechy la tentatrice que Laine tente une pénultième fois de prendre la fuite.
Sa dernière fuite lui sera fatale. Libéré d'une femme qui s'humilie totalement et se nie toute existence propre, lui imposant des chaînes qui soudain lui pèsent, il saisit l'argent offert comme moyen, non comme fin, froissant les billets comme l'on pose les pavés d'un chemin vers l'ailleurs.
Laine ne vend pas l'amour qu'il porte à Marthe - celui-ci n'est qu'une chimère de plus où il a cru bon de se perdre – il vend la pureté et l'altruisme de son amour à elle. Il vend un bien dont il ignore même la valeur, la liberté qu'elle lui a sacrifiée, le don de soi quasi christique qu'elle lui a fait en le suivant au bout du monde. Il croit échanger les chaînes d'une union contre la liberté du vent, mais comme les marins de Charybde en Scylla, se voit réduit à néant par l'instinct de possession d'une femme qui lui a fait croire que la liberté se pouvait toucher du doigt, tout simplement pour mieux l'enchaîner. Et son corps brisé que l'on détache du dos d'un cheval, ultime fuite dont il n'aura pu profiter, est le tribut versé à la pureté salie, à l'innocence vendue.
"Que les femmes sont bêtes"... Et quand Claudel l'écrit, c'est toutes les femmes qui lui font écho, se frappant le front, se frappant le coeur, se mordant les lèvres. C'est le choeur antique des relations perdues, la convocation du fantôme des illusions envolées, c'est l'amertume des rêves évanouis qui s'exprime par la voix de Marthe, qui ne comprend pas qu'on ne puisse plus l'aimer et qui voit dans la brièveté de ses songes dilués quelque chose de l'ombre d'une abeille.
La lumière qui se fait dans la salle... et l'on reste hébétés, encore sous le charme d'une langue d'ailleurs, d'une langue d'autrefois, d'une langue perdue, de mots intemporels, de mots qui touchent sans le savoir, de mots brandis comme un miroir à la face d'un monde moderne qui se perd encore et toujours et ne s'arrête jamais pour contempler ses erreurs.
Je ne pourrai plus dire que je n'aime pas Claudel.
(actuellement au Théâtre de la Colline)

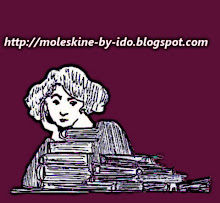

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire