 Un beau jour (ou était-ce une nuit ? non c'est trop facile), une personne fort estimée de ma connaissance (et dont j'emprunterais bien un croquis de livres pour illustrer ce billet s'il m'y autorisait... oui, ceci est une requête) me lança un défi. Oh bien sûr, une fois que l'on connaît la teneur de l'exercice, cela n'a rien de bien sorcier en soi. Mais pour moi qui ne connais aucune mesure en matière de lecture (la bibliophagie est une maladie qui n'implique pas la consommation littérale de papier d'imprimerie, non, enfin pas dans l'acception que je lui donne), cela relevait des douze travaux d'Hercule, voire des dix plaies d'Egypte.
Un beau jour (ou était-ce une nuit ? non c'est trop facile), une personne fort estimée de ma connaissance (et dont j'emprunterais bien un croquis de livres pour illustrer ce billet s'il m'y autorisait... oui, ceci est une requête) me lança un défi. Oh bien sûr, une fois que l'on connaît la teneur de l'exercice, cela n'a rien de bien sorcier en soi. Mais pour moi qui ne connais aucune mesure en matière de lecture (la bibliophagie est une maladie qui n'implique pas la consommation littérale de papier d'imprimerie, non, enfin pas dans l'acception que je lui donne), cela relevait des douze travaux d'Hercule, voire des dix plaies d'Egypte.
Car il me fallait, dans le flot mouvant et grossissant avec les années de mes lectures, n'en retenir que dix...
Dix livres dont la lecture avait, sans aller jusqu'à changer mon existence, provoqué en moi une réaction suffisante pour que j'en demeure marquée et un peu plus complète.
Il n'y avait là aucune contrainte qualitative, et j'eusse tout aussi bien pu citer un volume du Club des Cinq ... si j'avais lu ces ouvrages avec passion au point d'appeler mon chien Dagobert (ouf, j'eus une chienne, et non elle ne s'appela pas Lassie) ... ou encore un volume de Simenon si ma voie avait pris le chemin du 36 quai des Orfèvres (mais elle s'arrêta avant le carrefour, de toutes façons je me voyais mal fumer la pipe en dégustant de la blanquette de veau...).
Non, il fallait retrouver, en tirant sur les fils du temps qui passe, dix ouvrages marquants, non pour leur gloire littéraire reconnue mais pour l'importance qu'ils avaient pu avoir un jour à mes yeux. Voici donc cette liste, quasiment dans la version alors livrée, avec quelques ajouts mais, sur le fond aucune modification conséquente. Je persiste et signe quant à la composition de cette liste - mais Dieux que je hais les listes - quoique, la solution serait sans doute de dresser d'autres listes, comprenant d'autres critères... allez... un inventaire de mes bibliothèques ferait tout aussi bien l'affaire.
Les cavaliers, Joseph Kessel
Une remarque de ma jeune tante Isa un soir "Comment? Tu n'as pas lu "les cavaliers"??" L'urgence dans sa voix était sans appel. Lu donc avec une forte fièvre, en cachette bien entendu pour raison précitée; une nuit entière passée à suivre les sabots de Jehol, le cheval fou, sur les sentes escarpées des montagnes d’Afghanistan, à sentir le cuir des cravaches tressées des tchopendoz tâchant de se lacérer le visage sur le terrain de bouzkachi de Kaboul. Le plus beau cheval du monde, un homme à regard de loup qui cherche les limites de la bienveillance humaine, le dépassement de soi, la négation de la douleur, des paysages minéraux que l’on voit naître à mesure que l’on tourne les pages. La violence des hommes, la beauté de la sauvagerie, la simplicité des mots : autant de raisons qui ont fait que mes mains et mes yeux refusaient de quitter ce livre. Je l’ai souvent relu et je le sais là, à portée, comme un parfum familier ou une musique d’enfance, prêt à me soulager en cas de tourment ou de peine. Vous savez, cette sensation que l’on a de savoir que quelque chose est là si l’on en a besoin, qui rassure et réconforte, même si le besoin ne se présente pas encore.
Le côté de Guermantes, Marcel Proust
Cette phrase qui me fit pleurer je ne la retrouve plus. Ai-je bien cherché d’ailleurs ? Je préfère garder ce souvenir flou d’une idée qui évoque un paysage de campagne et la lueur du ciel derrière un toit, mais ma mémoire me trahit sans doute. Elle me reste fidèle en revanche lorsque je ressens de nouveau ce coup au ventre, cette évidence imparable qu’écrire c’est cela. Cela c’est composer une silencieuse musique à laquelle tout votre être répond et se sent comme aspiré par les mots dans un univers sensible et quasi palpable. Evidemment, il est difficile de choisir un titre parmi tous ceux de la Recherche, et j'ai longuement hésité entre celui-ci et le Temps retrouvé. Mais puisque l'exercice consiste à établir non une liste d'indispensables mais une liste émotionnelle... Oh et zut, pourquoi se limiter à dix? Pourquoi se priver ainsi de l'ironie amère, de l'admiration encore palpable mais non sans désabusement du narrateur devant la déchéance d'un Charlus ou devant une tribu Guermantes dont l'éclat n'est plus le même. Pourquoi se priver de cette étincelle qui nous rendra Mme Verdurin toujours agaçante mais un peu moins insupportable? Oh comme je déteste les listes.
Le Christ recrucifié, Nikos Kazantzaki
Des années de lycée naquirent les conflits et les doutes opposés à une éducation imprégnée de religion acceptée et non discutée – en dépit de l’amour paternel pour la pratique du doute philosophique – en bref, ce que l’on pourrait appeler une perte de foi. Ceux qui y verraient la malicieuse influence des cercles trotskistes se tromperaient lourdement, il n’y avait là que la sensation d’un mensonge et l’angoisse de la découverte, enfin, d’un grand vide face à l’homme. Le cinéma Saint-Michel brûla une nuit sous la main imprécatoire et hypocrite de quelques intégristes catholiques. Le film avait fait parler de lui, l’auteur du livre moins, et lorsqu’un camarade crétois m’offrit le Christ Recrucifié quelques mois plus tard, je découvris avec surprise que l’auteur était aussi celui qui avait donné naissance au scandale en évoquant une dernière tentation (quant à Zorba, il ne m’évoquait que la figure d’Anthony Quinn dansant sous le soleil, c’est fou comme on passe facilement à côté des choses). A mesure que j’avançais dans ce récit aux couleurs primaires, aux passions exacerbées et en même temps d’une grande simplicité d’expression, je sentais une résonance troublante, un écho qui cherchait à se faire entendre… Au final, il me sembla que cette foi que je pensais brûlée sur le bûcher du doute, attisé par le rejet de dogmes aux relents d’intolérance, cette foi anesthésiée, euthanasiée, mise à la porte, revenait par la fenêtre et s’imposait non plus comme une figure obligée et au cadre rigide, mais comme si le vide se remplissait tout à coup de quelque présence rassurante et familière, comme si l’absolu prenait un sens, ou, à défaut, se faisait tangible. Cette histoire d’hommes au milieu des pierres d’une île inhospitalière avait touché ce que ni St Augustin, ni la relecture attentive des évangélistes n’avait su retrouver.
L’Odyssée, Homère
Le premier contact se fit par l’Enéide un été d’ennui durant lequel mon père désespérait de trouver quelque ouvrage à me mettre sous les yeux pour que je cessasse enfin de geindre. Il retrouva l’Enéide en sa version prosifiée par quelque main généreuse dans un coin de grenier et se dit que, pour le coup, il aurait la paix et pour un bon moment. Hélas la paix ne dura pas, et la lecture fébrile des aventures et tracas d’Enée me laissa sur ma faim. De retour à Paris, il n’eût d’autre choix pour combler mon avidité que de me donner accès à deux volumes aux belles reliures figurant des guerriers achéens : L’Iliade et l’Odyssée, cette fois-ci dans toute leur splendeur poétique. Si le premier me plut pour le fracas des armes, Hector face à Achille, les dieux au balcon de l’Olympe tirant d’invisibles ficelles, ce fut toutefois l’Odyssée et son cortège de voyages plus extraordinaires encore que ceux de Jules Verne qui me fascinèrent totalement. Ulysse devenait le seul héros possible de toutes les aventures humaines. Ces lectures me happaient dans un monde à moi seul réservé dont il était difficile de me tirer. Après cela, je tâchai de connaître un peu mieux l’univers des mythes auquel il était fait référence dans certains vers, préférai la découverte de la mythologie à celle de l’histoire de la Grèce et de l’Asie Mineure, connus mieux la filiation de Zeus que celle de mes parents éloignés. Cela me conduisit tout logiquement à la découverte du théâtre classique, où les mythes et l’histoire se mêlaient à l’envi. Je brûlais pour Thésée, me damnais pour Jason, mais Ulysse demeura le gardien de cette porte ouverte où j’aurais voulu être Circé, Calypso, Nausicaa.
King Lear, Shakespeare
La fascination pour le pouvoir. L’alibi de la folie pour faire preuve de la plus grande des sagesses. La justice qui triomphe du mal – toujours rassurant en un sens. Difficile de déterminer une pièce parmi toutes celles qui me transportent chez Shakespeare. Le choix de celle-ci est simple : en dépit de toutes les difficultés que j’ai pu éprouver pour la lire en sa langue d’origine, elle fut ma première source d’émotion. Oh non, pas le sort injuste réservé à la pauvre Cordélia – qui comme nombre de personnages féminins d’ingénues chez Shakespeare n’est pas des plus consistant, enfin à mon sens – mais la déchéance de cet homme de pouvoir qui voit lui échapper les fils qui le maintenaient encore dressé au-dessus de la mêlée. La noirceur égoïste, veule et mesquine de l’âme humaine y côtoie la loyauté exemplaire et la fidélité des grands serments. Là où Macbeth me fascine par les jeux de pouvoir, Beaucoup de bruit pour rien m’amuse pour son côté witty et Richard III me ravit pour son approche politique, King Lear m’offre simplement le miroir de l’Homme avec toute sa palette.
Pride and prejudice, Jane Austen
Lecture repoussée pendant des années. Sans raison aucune, le livre resta dans la bibliothèque. Les premières phrases et l’échange entre Mr. et. Mrs Bennet me laissait froide. Et puis, un jour, sur un morceau d’épisode d’une version de la BBC où le jeu des acteurs était étincelant, je décidai de me lancer. Le charme incroyable de cet univers qui ressemblait à ces couronnes de mariée en fleurs d’oranger que l’on plaçait autrefois sous globe me prit au piège. Les règles de savoir-vivre en société me semblaient plus familières que les débordements populaciers de la littérature jeune et moderne. Je tombai inexorablement, et sans doute comme la majorité des jeunes filles, sous le charme glacial, compassé et en même temps irrésistible de M. Darcy. Très sincèrement, le fait que l’adaptation BBC ait donné les traits de Colin Firth à ce même personnage dut avoir quelque influence aussi sur le goût démesuré pour ce livre tellement relu que je dus en racheter un exemplaire, le premier ayant commencé à vivre une vie automnale en perdant quelques feuilles.
La Chute, Albert Camus
Une lecture imposée pour le bac français. Laborieuse au départ, j’avoue avec honte que je ne faisais pas consciencieusement mes préparations de texte en vu des cours suivants et que j’arrivai plus d’une fois en cours sans aucune idée de ce qui figurait dans le texte du jour.
Jusqu’à ce matin-là… Mon professeur, femme exigeante et glacialement efficace, me désigna sans appel pour lire et analyser un bon morceau de l’un des chapitres. J’ouvris prudemment mon cahier à la page concernant le chapitre précédent, afin de simuler à distance le sérieux d’une préparation et découvris le texte à mesure que je le lisais. Le temps de l’analyse me parut laborieux mais les idées me venaient pourtant sans douleur, je glissais sans trébucher des cercles camusiens aux cercles dantesques et réussis à terminer l’épreuve sans montrer trop d’ignorance, mais pas assez toutefois pour que ma redoutable examinatrice ne me jette un regard entendu en commentant l’excellence de l’analyse que j’avais préparée. Première surprise de m’être si bien tirée d’affaire, je résolus donc de m’attaquer à cet ouvrage avec un peu plus d’envie au ventre.
La lecture soupirante et lassée d’avance céda le pas à la découverte passionnée de l’homme et de son double, du juge et de l’accusé, de l’âme en abyme aux profondeurs vertigineuse. Jean-Baptiste Clamence devint un peu mon double, je le découvris, le soupesai, le disséquai sans pitié, certains diront que c’était pour m’y trouver moi-même sans doute. Camus, pour moi ne fut jamais l’homme de l’Etranger ou de la Peste - je les lus du reste fort tard - mais restera l’homme de la Chute, de cette rencontre qui me fait penser à la chanson « comme à Ostende » pour je ne sais quelle étrange raison, de cet homme qui parle à son propre fantôme.
Romancero Gitano, Federico Garcia Lorca
Chaque poème a son histoire, chaque histoire a ses couleurs. Loin des touches impressionnistes (on glisse parfois vers le fauve pour finir en expressionnisme) des sonetos ou des gacelas, le romancero (recueil de romances, forme poétique ancienne) garde une dimension épique qui projette sa fresque sur un mur de chaux andalou. Il y a du tragique derrière les touches folkoriques dont l’évocation de l’univers des gitans d’Espagne se passe difficilement. Le romance se raconte, il descend en droite ligne et sans guère de modification de la chanson de geste, il a une musique particulière et hypnotique. Couleurs, musique, thèmes familiers et tragédie à l’antique. Ma première lecture du romancero me laissa sans voix… « El niño vino a la luna con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando », « Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña ». Comprendre les mots n’était une plus une nécessité absolue, les vers glissaient comme l’eau d’un ruisseau sur un lit de rochers, tintinnabulaient comme des clochettes d’argent, convoquaient la lumière et l’ombre. Plutôt que de chercher à comprendre, il suffisait de se laisser porter par la mélodie de la scansion, et l’univers de ces portraits gitans devenait sensible. Le romancero ne me quitta plus, j’en ai d’ailleurs toujours quatre éditions différentes, non pour le texte, puisqu’il demeure dans sa langue d’origine, mais pour l’appareil critique l’accompagnant et notamment les références plus ou moins précises aux notes et corrections apportées par Lorca au manuscrit original. Du lycée à l’université, ces poèmes restèrent à portée de mes mains en permanence, pour certains au fond de ma mémoire et j’eus une fois même l’opportunité d'en faire une étude plus approfondie sous la houlette d'un grand Monsieur, professeur et poète, hélas disparu.
Dom Juan, Molière
Dom Juan c’est à la fois le Tenorio de Tirso et de Zorrilla, c’est aussi celui de Mozart et Da Ponte, mais c’est avant toute chose Philippe Jacquenot interprétant le rôle de Louis Jouvet (d’après les notes de ce dernier) expliquant à une de ses élèves de conservatoire comment interpréter le rôle d’Elvire. Nous avons dès lors tous rêvé en cette année de bac français de tomber sur cette tirade-là qui débutait ainsi : « Ne soyez point surpris, dom Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage(…) ». Ce fut un Dom Juan par Weber, sur scène avec Huster en Sganarelle inattendu, ce fut, plus tard, un trou de François Chaumette sur la scène du Français, à l’époque avec mes camarades de licence nous cherchions à nous remémorer et à faire le tour de tous les Don Juan recevables. Bien qu’éprise du Tartuffe et du Misanthrope, je ne saurais, le choix m’en fût-il donné, choisir d’autre pièce comme unique exemplaire de l’œuvre de Molière à conserver et à chérir.
Trop de plaisir à lire, relire, à haute voix parfois, ces répliques intemporelles et dont l’insolence ne prendra pas de rides. Si j’avais pu faire du théâtre, je me serais damnée pour être une fois, oh juste une fois, cette Elvire charmante d’instabilité et de feu.
Sur les falaises de marbre, Ernst Jünger
Je ne m’y suis pas attaquée de ma propre initiative, ne connaissant de Jünger que le nom et me sentant jusque-là aucune curiosité pour le travail de cet auteur (encore un défaut de ce champ linguistico-culturel qui, comme vous l’avez déjà relevé, nous fait passer à côté de choses qui auraient sans doute su nous plaire en des moments donnés). Mais le verdict était sans appel, il « fallait » (je cite) avoir lu cet ouvrage précis. Je m’en procurai donc un exemplaire, en traînant des pieds en fille peu adepte des lectures « obligatoires ». Contrairement à mes appréhensions, que ne parvenait pas tout à fait à chasser la poésie du titre, j’entrai dans ce récit hors des temps et espace connus comme on entre au cœur de l’hiver dans une maison accueillante où attendent un bon feu et un breuvage bouillant et réconfortant. Moi qui craignais de ne pas retrouver mes marques en raison de ce fameux décalage, je me sentis pourtant en terrain familier. Je me pris au jeu de cette attente, de cette implacable vague de violence qui guette et se rapproche, la citadelle devenait mienne, j’en connaissais les rues et les moindres recoins. Je découvris avec surprise le contraste saisissant entre une appréhension culturelle – sans doute infondée mais il était difficile d’en juger a priori – et le sentiment déroutant de familiarité, ce dernier procuré par cette sensation de retour chez soi, d’une chaleur indéfinissable et sans doute ridicule pour autrui, en bref d’adéquation parfaite. Ce livre n’avait pu être écrit pour un autre lecteur que moi, tel est le sentiment qui s’installait au fil de ma lecture. Je lus d’autres ouvrages de Jünger, en appréciant le style au rasoir et les univers parfois improbables, mais aucun ne me procura ce sentiment d’appartenance à un même univers.

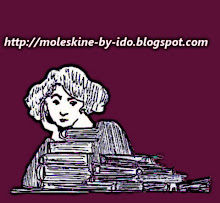

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire